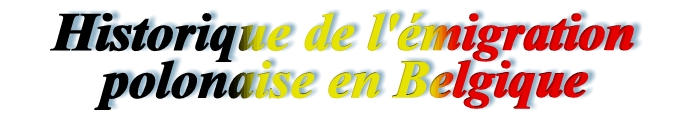
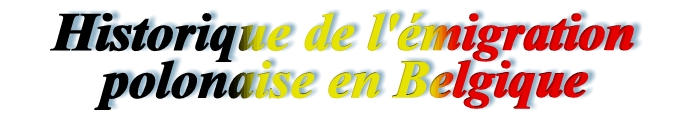
C] Période de la Seconde Guerre Mondiale
1. Participation des Polonais
En 1939, les organisations polonaises se sont occupées de l'engagement de volontaires pour l'armée polonaise en France. Durant les premiers mois de la guerre, 1.100 volontaires ont été envoyés au camp militaire Coëtquidan (école militaire) en France. A cette époque, tous les Polonais se sont cotisés d'un jour de salaire mensuel pour un impôt national. La résistance polonaise n'a pas constitué une force indépendante mais les Polonais se sont plutôt intégrés dans les formations belges et ont créé, selon leur possibilité, leurs propres sections et groupes.
En 1941, des polonais de tendance gauche participèrent à un mouvement de résistance belge, dans la région de Liège. Sur les 340 membres, 120 étaient polonais. Les Belges furent dirigés par le colonel Miraut et les Polonais par le major Pietruszka. Ils agissaient également dans les régions de Charleroi, Anvers, Gand et Bruxelles. Dans les environs de Mons, 150 Polonais ont participé à des sabotages contre l'occupant et à l'exécution des collaborateurs.
 Les communistes
polonais sous le commandement d'Edward Gierek
Les communistes
polonais sous le commandement d'Edward Gierek![]() maintenaient leurs actions sur le territoire du
Limbourg, à Waterschei, Winterslag, Zwartberg, Eisden et Beringen, où ils sabotaient les
moyens et les voies de transport allemands. Mais ils détruisaient aussi les productions
des entreprises occupées et organisaient les évasions des prisonniers russes. De plus,
il s'occupait aussi de la rédaction d'un journal clandestin. En 1942, au Limbourg, à
l'initiative de Edward Gierek, ces résistants belges et polonais se regroupèrent afin de
former une seule organisation appelée "Witte Brigade", qui comptait environ
3000 Belges et Polonais.
maintenaient leurs actions sur le territoire du
Limbourg, à Waterschei, Winterslag, Zwartberg, Eisden et Beringen, où ils sabotaient les
moyens et les voies de transport allemands. Mais ils détruisaient aussi les productions
des entreprises occupées et organisaient les évasions des prisonniers russes. De plus,
il s'occupait aussi de la rédaction d'un journal clandestin. En 1942, au Limbourg, à
l'initiative de Edward Gierek, ces résistants belges et polonais se regroupèrent afin de
former une seule organisation appelée "Witte Brigade", qui comptait environ
3000 Belges et Polonais.
En même temps, à l'initiation du gouvernement
polonais à Londres, l'Organistion de la Lutte polonaise pour l'Indépendance a
été fondée afin de diriger toutes les autres associations de Polonais en Belgique et en
France. Elle a compté environ 500 membres qui agissaient sous l'ordre du gouvernement à
Londres. Ces derniers, toutes tendances confondues (de gauche et de droite), avaient pour
mission de collaborer ensemble, espionner afin d'apporter des renseignement aux alliés et
ils se préparaient surtout à la mobilisation future lorsque les alliés agiront pour de
bon. Entre les années 1940 et 1944, plus de 2.000 Polonais ont participé dans la
résistance en Belgique.
 Durant la période du 6
septembre au 2 octobre 1944, la première Division Blindée du Général Stanislaw Maczek
libérait la Flandre Orientale, la Flandre Occidentale et la province d'Anvers. Elle a
libéré, entre autres, Poperinge, Ypres (Ieper), Roeselare, Tielt, une partie de Gand,
Saint-Nicolas (Sint-Niklaas), Beveren, Lokeren, Beerse et Merksplas mais aussi en Zélande
Hollandaise, Hulst, Axel et Ternneuzen. Beaucoup de soldats ont payé de leur vie cette
libération. Dans les cimetières belges reposent 360 soldats de cette division. Au
cimetière militaire polonais, à Lommel, reposent 257 soldats, principalement de cette
première Division Blindée.
Durant la période du 6
septembre au 2 octobre 1944, la première Division Blindée du Général Stanislaw Maczek
libérait la Flandre Orientale, la Flandre Occidentale et la province d'Anvers. Elle a
libéré, entre autres, Poperinge, Ypres (Ieper), Roeselare, Tielt, une partie de Gand,
Saint-Nicolas (Sint-Niklaas), Beveren, Lokeren, Beerse et Merksplas mais aussi en Zélande
Hollandaise, Hulst, Axel et Ternneuzen. Beaucoup de soldats ont payé de leur vie cette
libération. Dans les cimetières belges reposent 360 soldats de cette division. Au
cimetière militaire polonais, à Lommel, reposent 257 soldats, principalement de cette
première Division Blindée.
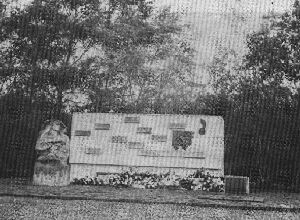

2. Sort des Polonais
La politique expansionniste d'Adolf Hitler à la fin des années trente représenta un grave danger pour la sécurité de la Pologne. Après les accords de Munich et l'anéantissement de l'Etat tchécoslovaque, en mars 1939, la Pologne devint la cible principale de la diplomatie allemande. Fin mars, les Allemands exigèrent que la Pologne consente à leur céder Gdansk (Danzig) mais les Polonais, assurés par les Anglais et les Français, refusèrent.
Le 1er septembre 1939, l'Allemagne attaqua la Pologne après avoir signé un pacte avec l'Union soviétique. Ce fut le début de la Seconde Guerre Mondiale.
A la mi-septembre, les armées allemandes conquirent l'essentiel de la Pologne occidentale et centrale. Le 17 septembre, les troupes soviétiques envahirent l'est de la Pologne, et les deux envahisseurs se partagèrent le territoire polonais. Des représailles considérables furent exercées contre les Polonais à travers la zone d'occupation allemande. Depuis la zone d'occupation soviétiques, des milliers de Polonais furent déportés en Sibérie.
De nombreux membres du gouvernement et des forces
armées polonaises parvinrent à s'échapper au cours des phases finales des opérations
militaires allemandes et soviétiques contre le pays. La plupart des troupes polonaises
réfugiées, près de 100 000 hommes, réussirent à atteindre la France et la Belgique,
où elles furent regroupées en unités de combat. Entre-temps, un gouvernement en exil,
avec à sa tête le général Wladyslaw Sikorski![]() , fut mis sur pied en France. Au lendemain de la défaite de la France en 1940, le
gouvernement polonais s'établit définitivement à Londres
, fut mis sur pied en France. Au lendemain de la défaite de la France en 1940, le
gouvernement polonais s'établit définitivement à Londres![]() .
.
Au cours de la phase initiale de leur attaque contre l'Union soviétique en 1941, les forces armées allemandes envahirent tous les territoires polonais occupés par les Soviétiques. Pendant leur occupation du pays, les armées allemandes appliquèrent une politique d'extermination systématique des citoyens polonais, en particulier des juifs, dont la plupart périrent à Oswiecim (Auschwitz), Treblinka, Majdanek, Sobibor et dans d'autres camps de concentration disséminés à travers toute la Pologne. En avril 1943, les juifs du ghetto de Varsovie, plutôt que d'attendre, ans réagir, d'être assassinés dans les camps, choisirent la rébellion mais elle fut sans sucés. A la fin de la guerre, le total estimé de victimes civiles atteignit 5 millions et les pertes militaires de la Pologne atteignirent 600 000 hommes.

La libération de la Pologne du joug allemand commença peu après l'invasion anglo-américaine de la France en juin 1944. Les armées profitèrent de la situation des allemands pour leurs infliger des défaites écrasantes. En août 1944, les forces de la résistance polonaise, connues sous le nom de "Armia Krajowa" (Armée Intérieure), prirent le contrôle de Varsovie. Mais en octobre, les Allemands revinrent en force et reconquièrent la ville en la rasant après avoir fait évacuer la population. Les ruines de Varsovie tombèrent aux mains de l'Armée rouge en janvier 1945. En juillet 1944, l'Union soviétique installa, à Lublin, un Comité de libération nationale polonais, largement dominé par des communistes. Ce comité s'autoproclama gouvernement provisoire de la Pologne au mois de décembre.
Lors de la conférence de Postdam, en août 1945, les Alliés déterminèrent la frontière occidentale de la Pologne. La frontière orientale fut déterminée par le traité conclu entre les gouvernements polonais et soviétique du 16 août 1945. Cette frontière fut placée bien plus à l'ouest que la frontière d'avant-guerre et la Pologne perdit l'Ukraine et la Biélorussie.