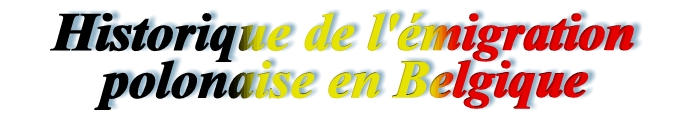
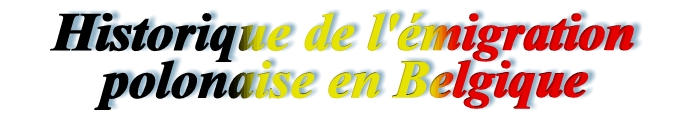
B] Période d'entre deux guerres
1. Emigrations
1.1) Recrutement d'ouvriers
Durant la Première Guerre Mondiale, le peuple belge était amenée à se battre sur le front. Pour échapper au recrutement, la plupart d'entre-eux préféraient travailler dans les mines où ils considéraient qu'il y avait moins de dangers. Lorsque les premiers allemands envahirent la Belgique, le reste de la population et les prisonniers de guerres étaient également envoyés dans les mines et les autres lieux de production de matières premières.
Dans les années d'après-guerre, en raison de la forte mortalité et de la diminution du taux naturel de croissance, la Belgique fut atteinte par un déficit en population. De plus, un mouvement accentué d'émigration d'ouvriers qualifiés belges se déplaça vers les départements du nord et de l'est de la France décimés par la guerre, où ils trouvèrent un travail mieux payé. La Belgique manifesta donc un besoin accru en ouvriers étrangers lié au manque de forces productrices, plus particulièrement dans les mines de charbon où la production ne couvrait pas les besoins du pays.
En outre, une soudaine répugnance pour le métier de mineur saisit les belges et les mines se vidèrent de leurs ouvriers. Déjà avant la Première Guerre Mondiale, les mineurs refusaient d'envoyer leurs enfants dans les mines. Les femmes disaient : "Fille de mineur, femme de mineur, çà suffit! Mère de mineur? Jamais!" Mais puisqu'aucun autre secteur ne demandait de mains d'œuvres peu qualifiée, ils avaient dû accepter leur situation.
Mais après cette Première Guerre Mondiale, un nouveau besoin de mains d'œuvres apparaissaient, pour la reconstruction des bâtiments détruits par les allemands. En vain, le gouvernement améliora les conditions de vie des mineurs, mais ceux-ci ne voulurent plus retourner travailler dans les mines puisqu'un autre secteur s'était ouvert à eux.
Pour que le pays ne sombre dans une trop grande pauvreté due à un manque de mineurs, le gouvernement belge livra les prisonniers de guerre aux mains des propriétaires des mines. Ces ouvriers travaillèrent donc pour le compte de la Belgique et relancèrent notre production minière. Malheureusement, lorsque ces prisonniers retrouvèrent leur liberté, ils en profitèrent pour retourner dans leur pays et ainsi, ils abandonnèrent les mines. Le gouvernement décida que le seul moyen de trouver une autre main d'œuvres en grand nombre fut donc de recruter à l'étranger.
Parmi les arrivants, dans les premières années
d'après-guerre, la plus grande partie était constituée par les Westphaliens,
c'est-à-dire les Polonais habitants en Westphalie et en Rhénanie (Allemagne). Ceux-ci
étaient embauchés dans les exploitations minières et les industries lourdes mais à
cause de la nouvelle situation politique et économique de l'Allemagne, ils durent la
quitter. Une partie d'entre eux est d'abord retournée au pays mais, n'y trouvant pas
d'emploi, ceux-ci ont préféré se rendre en France et en Belgique. Cette première vague
de courant accentué de Polonais dura de 1920 à 1924![]() . Dans cette période, 3360 personnes arrivèrent en Belgique (selon les registres
belges).
. Dans cette période, 3360 personnes arrivèrent en Belgique (selon les registres
belges).
En 1922, le service de l'immigration polonaise a
collaboré avec son homologue belge. Sur cette base, on a effectué le recrutement
d'ouvriers conformément aux besoins des employeurs belges. Ces ouvriers venaient en
transports collectif. L'arrivée sans famille ou proches constituait une condition
importante de l'accord. Le contrat était signé pour un an et ensuite, l'ouvrier pouvait
retourner en Pologne. Dans la pratique, les Polonais étaient encouragés à séjourner
plus longtemps ; ils avaient une réputation de gens disciplinés et de bons ouvriers![]() .
.
Entre les années 1920 et 1924, selon les données belges, 3.360 Polonais sont arrivés en Belgique en provenance d'Allemagne.
1.2) Emigrations à contrat et clandestines
Entre les années 1925 et 1929, une des plus grandes
émigrations polonaises a eu lieu. C'était une émigration venant principalement des
voïevodies, divisions administratives polonaises, du sud-ouest (Cracovie, Lodz, Poznan).
En 1930, l'état de la Polonia![]() en Belgique
fut estimé à 50.629 personnes.
en Belgique
fut estimé à 50.629 personnes.
La forme la plus fréquente et la plus facile d'émigration était celle à contrat. En effet, on garantissait aux émigrés le travail et le logement.
Il y avait également une émigration clandestine. Les directions des mines étaient intéressées par cette main d'œuvre, à la fois facile et moins coûteuse, et ils ont donc facilité l'obtention de documents nécessaires à ces clandestins.
Les conditions de travail dans les mines belges, principalement à
Liège, étaient très dures ; le taux de mortalité y étaient important. Les Polonais ne
pouvaient pas facilement avoir de promotion. Les postes clés leur étaient hors
d'atteinte. Les Polonais étaient de bons travailleurs mais le plus haut poste qu'ils
pouvaient obtenir était celui de chef porion![]() . Les hautes
fonctions exigeaient une instruction supérieure que l'émigrant polonais n'avait pas.
. Les hautes
fonctions exigeaient une instruction supérieure que l'émigrant polonais n'avait pas.
1.3) Crise économique
Pendant la période de la crise économique en Europe, de 1930 à 1934, l'afflux de populations polonaises en Belgique diminua fortement. Seulement 7.200 Polonais ont réussi à émigrer en Belgique. En effet, la politique libérale du gouvernement belge envers les étrangers changea de tournure : les ouvriers étrangers ne purent arriver en Belgique qu'après l'obtention de l'accord du Ministère de la Justice, possédant un passeport et un visa.
Une des causes de l'émigration des Polonais en Belgique est aussi la crise économique envahissant la France. L'état belge est l'un des premiers à s'être débarrassé des conséquences de la crise mondiale, et de nouveau, il fallut résoudre le problème du manque de main d'œuvre. Les besoins croissants en forces productrices ouvrirent les frontières aux étrangers polonais. La Polonia belge (ensemble des citoyens belges d'origine polonaise) s'accrut dans les années 1935-38 et s'éleva à la fin de 1938 à 61.809 personnes.
Les régions à la concentration de Polonais la plus grande étaient Liège, Limbourg, Charleroi, Mons et la région de Mons (le Borinage).Des agglomérations de quelques milliers de citoyens polonais existèrent aussi à Anvers, Gand et Bruxelles, mais ce fut en plus grande partie une population juive.
Cette répartition spécifique fut déterminante pour les besoins du marché du travail belge, plus particulièrement pour les mines de charbon qui, en raison des conditions de travail très dures et dangereuses n'étaient pas des endroits d'embauches attractifs pour les Belges, ce qui provoqua l'arrivée d'émigrés polonais.
2. Organisations polonaise durant la période d'entre deux guerres
2.1) Organisations
Elles se créèrent immédiatement après la Première Guerre Mondiale, avec l'arrivée des émigrants de Westphalie et de Rhénanie. Ceux-ci établirent des organisations à caractère professionnel (association des mineurs sous l'invocation de Sainte Barbara), des associations catholiques (confrérie de Rosaire Vivant), culturelles (de chant, de théâtre) et sportives.
Les organisations les plus nombreuses et influentes étaient l'Union des Polonais en Belgique (créée en 1923), l'Association du Scoutisme Polonais (fondée par Jozef Zorawski) et l'Association de Gymnastique "Sokol". Il y avait aussi l'Union des ex de l'Armée et l'Union des Tirailleurs (créée dans les années trente et qui dura jusqu'au déclenchement de la Seconde Guerre Mondiale). L'Union Centrale des Associations Polonaises en Belgique s'occupait de la coordination de toutes ces organisations.

2.2) Rôles des organisations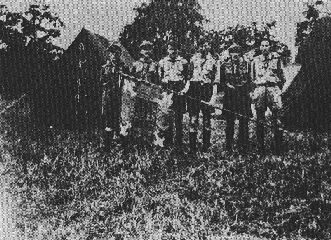
Le scoutisme a été l'une des plus importantes organisations. Les écoles polonaises n'existaient pas, on les remplaçait par des cours de langue polonaise et des classes polonaises dans les écoles belges. Elles avaient une très grande influence sur la jeunesse polonaise. La première équipe a été fondé à Binche, les suivantes au Limbourg, Beringen et Winterslag.
En 1936, le scoutisme polonais comptait 1.224 personnes ce qui était à l'époque d'une grande importance. Le scoutisme a fonctionné jusqu'au déclenchement de la Seconde Guerre Mondiale et a contribué à garder l'esprit national parmi la jeunesse polonaise.
En janvier 1924, l'Association de Gymnastique "Sokol" a été créée et elle avait une grande popularité dans le milieu polonais. Ces organisations se situaient principalement au Limbourg, à Winterslag, Waterschei, Eisden et Heusden (Limbourg). Après la Seconde Guerre Mondiale, elles n'ont plus continué leur activité.
Dans les années trente, à l'initiation du gouvernement polonais, l'Union des Tirailleurs a été créée et elle a eu 1.000 membres.
La Confrérie du Rosaire Vivant, créée en 1933
par un curé belge![]() au Limbourg, menait
une activité importante. Elle est encore active aujourd'hui.
au Limbourg, menait
une activité importante. Elle est encore active aujourd'hui.